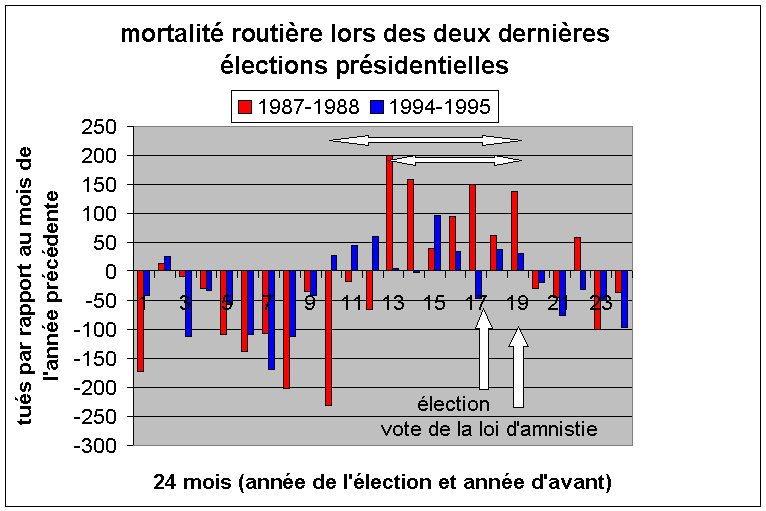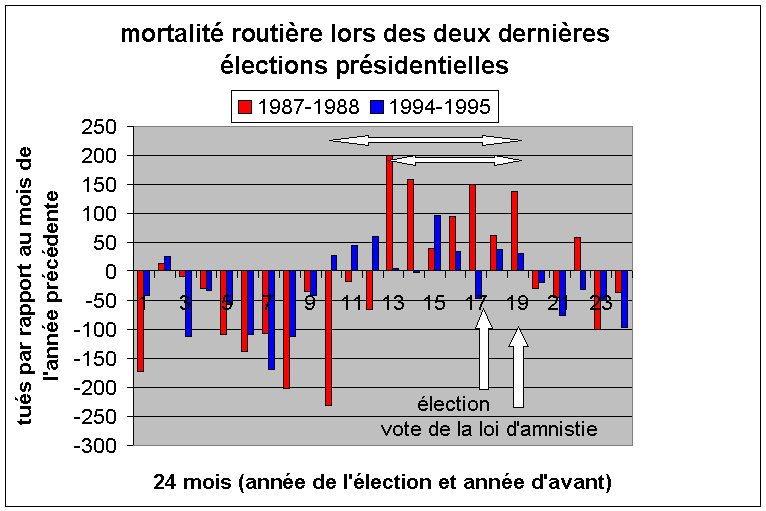décembre 2001
Accueil | Table des matières |
Liste des éditoriaux
Amnistie (suite)
Le débat public sur l'amnistie prend une telle ampleur
que j'ai repris en le complétant le dossier établi en Mai dernier (éditorial de
mai 2001).
Le plan du dossier est le suivant :
Résumé du problème
La pratique d'une amnistie suivant l'élection du
Président de la République est apparue avec le recours au suffrage universel
pour cette élection. La première loi d'amnistie fut adoptée en 1966. Il est donc
faux d'affirmer que c'est une "tradition républicaine", cette forme systématique
et donc prévisible de l'effacement des fautes pénales est récente et aucune
autre république au monde ne la pratique sous cette forme. En pratique les
caractéristiques de l'amnistie sont définies par le Parlement dans une loi, mais
le rôle parlementaire se limite en pratique à des amendements au projet de loi
déposé par le gouvernement qui ne le modifient pas au fond. Il faut également
tenir compte de la concordance entre la majorité parlementaire et la
majorité présidentielle lors du vote des 6 lois d'amnistie votées entre 1966 et
1995.
Quand une amnistie est "automatique" et donc
prévisible, il est possible d'anticiper sa survenue et d'adapter son
comportement à cette perspective. Le fait le mieux connu est la régression du
respect des règles de stationnement pendant la période qui précède l'amnistie.
Les excès de vitesse les plus nombreux et plusieurs fautes de conduite ayant été
incluses dans le champ des dernières lois d'amnistie, l'effet dissuasif de la
sanction de ces fautes disparaît pendant la période concernée.
L'analyse de la relation entre l'amnistie et la
sécurité routière routière doit tenir compte de deux groupes de faits :
- la présentation qui en est faite dans les médias,
notamment la période et la forme de ces interventions. Il faut remarquer que
l'élection de 1974 ne permettait pas d'anticiper
- les indicateurs de l'insécurité routière, j'ai choisi dans ce dossier
l'évolution de la mortalité qui est la conséquence à la fois la plus grave et la
mieux documentée de l'accident de la route.
J'ai développé une nouvelle présentation graphique de
la surmortalité routière lors de la période qui précède et celle qui suit la loi
d'amnistie, des commentaires sur l'évolution de la situation et une analyse
statistique de ces faits.
Lors de l'élection présidentielle de 1995, l'annonce de la
surmortalité routière provoquée par l'amnistie présidentielle avait été l'objet
de commentaires limités dans les médias. La situation est très différente cette
année. Plusieurs raisons se sont cumulées pour que ces morts programmées de sang
froid, "au nom de la tradition républicaine" deviennent insupportables :
-
L'élection de 1995 est venue conforter nos constatations de
1988, il y a eu à nouveau une forte augmentation de la mortalité fin 1994 et
début 1995 alors que le début de l'année 1994 marquait la poursuite de
l'abaissement de la mortalité routière observée dans notre pays depuis l'été
1973. Comme en 1988 le retour à de meilleurs résultats ne s'est effectué que
dans le mois qui a suivi le vote de la loi d'amnistie. Ces évolutions sont
particulièrement nettes si l'on complète les graphiques présenté en mai
dernier par une autre représentation de cette évolution de la mortalité
comparant chaque mois au mois équivalent de l'année précédente, pendant
l'année qui précède l'élection et l'année de l'élection.
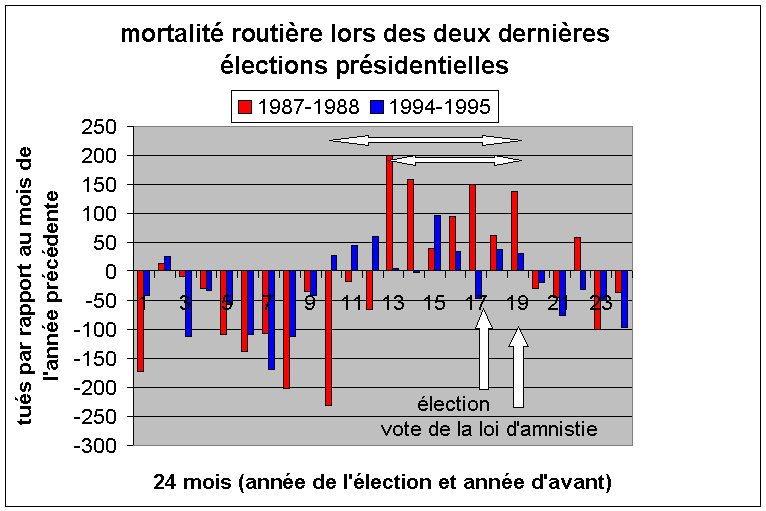
-
Le constat d'une bonne correspondance entre le moment de
l'annonce dans la presse de l'amnistie à venir et ses effets sur la
mortalité. L'annonce a été plus précoce en 1994 qu'en 1987 et l'effet sur la
mortalité a été également plus précoce (la flèche horizontale la plus haute
indique la période d'accroissement de la mortalité d'octobre 1994 à juillet
1995, la plus basse celle de janvier à juillet 1988). En 2001/2002 l'effet
ne pourra pas avoir un début aussi net car les médias spécialisés ont
commencé à parler de l'amnistie en mars 2001, soit plus d'un an avant
l'élection. Le comportement asocial s'est nécessairement combiné à la
prudence pour évaluer à partir de quel moment l'on pouvait prendre le risque
de mépriser le code de la route ! en outre le débat public (nul en 1987,
personne n'envisageait cet effet pervers de l'amnistie) a été beaucoup plus
important qu'en 1994/1995 et de nombreux infractionnistes en puissance
doivent envisager la possibilité qu'il n'y ait pas d'amnistie.
-
Plusieurs associations ou structures ayant un intérêt
particulier pour la sécurité routière, ou simplement pour le civisme et le
respect du droit se sont manifestées, interpellant de façon très directe les
responsables politiques. La dernière en date de ces prises de position étant
celle des maires de France le 23 novembre 2001. Le 9 octobre dernier, le
Président de la République a invité des acteurs de la lutte contre
l'insécurité routière, et la demande de renoncement à l'amnistie de toute
faute de conduite a été exprimée avec une netteté qui ne laisse plus de
place aux propos ambigus. L'expérience de 1995 a montré qu'il est facile sur
un tel sujet de prendre une position pseudo-sécuritaire en utilisant des
termes à double sens dans lesquels chacun va comprendre ce qu'il espère. Il
est particulièrement important que les questions posées aux candidats au
cours des semaines à venir fasse référence non pas à la sécurité routière,
mais à des infractions précises. Il faut être intellectuellement malhonnête
pour affirmer que l'on est opposé à toute amnistie des fautes mettant en
danger la vie des autres usagers, si l'on envisage par là de ne pas
amnistier le délit de mise en danger d'autrui, alors que l'on sait qu'il
était déjà exclu de l'amnistie dans la loi de 1995. En outre la Cour de
Cassation a pratiquement exclu la grande majorité des fautes de conduite du
cadre de ce délit en affirmant qu'un grand excès de vitesse sur autoroute ne
mettait pas en danger la vie d'autrui au sens de la loi ! Le bon sens peut
faire comprendre que toute faute de conduite met en danger la vie des autres
usagers, car on imagine mal pourquoi des règles concernant le respect des
limites de vitesse ou de la signalisation auraient été mises en oeuvre si ce
n'était pour assurer la sécurité.
-
Le nouveau Conseil national de la sécurité routière a pris une
position claire sur l'amnistie dès sa première réunion : "Il demande avec
insistance aux pouvoirs publics, aux candidats, aux formations politiques,
l'engagement public de renoncer à toute décision de cette nature afin
d'enrayer le relâchement des automobilistes que l'on constate à l'approche
de cette échéance et d'éviter ainsi le décès de plusieurs centaines de
personnes et de faire des milliers de personnes handicapées". "Il faut qu'il
y ait une tolérance zéro" à ajouté le président de ce conseil, M.Dosière.
Je vais tenter de réunir sur le site toute les positions écrites
des candidats ou des partis politiques (c'est le Parlement qui vote la loi
d'amnistie, même si c'est le gouvernement qui rédige le projet de loi, en accord
bien sûr avec le Président en dehors d'une période de cohabitation où il peut y
avoir une discordance entre les deux attitudes. Il est possible qu'au printemps
prochain le Président élu ait pris sur l'amnistie des positions qui ne seront
pas suivies par un Parlement appartenant à une autre famille politique que la
sienne).